Le Département des Sciences biomédicales de l'Université de Namur se focalise sur le développement d'outils et de techniques dédiés à la compréhension du fonctionnement du corps humain à l'échelle moléculaire, cellulaire et organique. Son objectif est de créer de nouvelles thérapies et dispositifs technologiques pour améliorer la santé et la qualité de vie des individus. En formant les chercheurs de demain avec une approche pédagogique active et innovante, le département prépare les étudiants à leur avenir.
De plus, il offre aux étudiants la possibilité de découvrir diverses opportunités professionnelles dès le Bachelier, que ce soit en Belgique ou à l'international, en collaborant directement avec des entreprises !
En savoir plus sur le Département des sciences biomédicales
À la une
Actualités

Charlotte Beaudart : Une chercheuse engagée dans le bien vieillir
Charlotte Beaudart : Une chercheuse engagée dans le bien vieillir
Depuis environ une décennie, une maladie attire l’attention de la communauté médicale. Son nom : la sarcopénie. Cette pathologie touche plus de 10 % des plus de 65 ans et se caractérise par une perte importante de la masse et de la force musculaire. Charlotte Beaudart, membre du Département de sciences biomédicales et de l'Institut de recherche NARILIS, s’est imposée sur la scène internationale ces dernières années en contribuant à mieux comprendre cette maladie et à la faire connaître.

Qu’est-ce qui vous a amenée à vous spécialiser dans le domaine du vieillissement ?
Tout a démarré avec ma thèse de doctorat. On m’a proposé de travailler sur la sarcopénie, un sujet alors peu exploré en 2012. C’était le tout début : on commençait seulement à parler de cette maladie. La thématique m’a immédiatement intéressée et j’ai rapidement remarqué que la recherche dans ce domaine était encore à un stade embryonnaire ! J’ai lancé une étude de cohorte sur 530 patients de plus de 65 ans qui ont été suivis durant une dizaine d’années. Ces données ont permis de publier de nombreuses études. C’est seulement en 2016 que la sarcopénie a été reconnue comme une pathologie à part entière. Jusque-là, elle était peu connue du grand public et des professionnels de la santé. De plus, il existait un tas de définitions de la maladie, ce qui entretenait une certaine complexité. J’ai rejoint un groupe d’experts internationaux, le GLIS (Global Leadership Initiative in Sarcopenia), qui travaille actuellement à établir une définition mondiale et consensuelle de la sarcopénie. On avance donc enfin vers une définition claire et une plus grande sensibilisation à la maladie, notamment auprès des médecins.
Justement, comment définit-on la sarcopénie ?
Aujourd’hui, la sarcopénie se définit par une perte progressive et généralisée de force et de masse musculaire avec l’avancée en âge, au-delà du seuil physiologique. Tout le monde perd du muscle en vieillissant, mais on remarque que certains en perdent beaucoup plus que d’autres. Nous cherchons à comprendre cette variabilité interindividuelle, qui est influencée par de nombreux facteurs : génétiques, métaboliques, etc.
Quel est le pourcentage de personnes touchées ?
Cette maladie touche énormément de personnes âgées. On estime ainsi qu’entre 10 et 16 % des plus de 65 ans sont atteintes de sarcopénie. Ce chiffre monte à 60 % pour les personnes hospitalisées, dans un service d’oncologie par exemple.
Pourquoi mérite-t-elle une attention particulière ?
Outre sa prévalence importante, ses conséquences sont lourdes : chutes, fractures, hospitalisations, perte d’autonomie, baisse de la qualité de vie et, c’est très clair, une mortalité accrue. De nombreux travaux commencent également à montrer l’importance des coûts de santé associés à la sarcopénie. L’impact de la sarcopénie se mesure donc au-delà d’un impact individuel, on peut parler d’un véritable impact sociétal !
C’est une question de santé publique sous-estimée selon vous ?
Ça l’était clairement il y a quelques années, mais la situation évolue. La recherche explose et les médias commencent à s’y intéresser. Les politiques y accordent également de plus en plus d’attention, ce qui est très positif. On a tous envie de bien vieillir et de préserver ses capacités physiques.
Vous avez développé un outil spécifique, le SarQol. De quoi s’agit-il ?
Le SarQol est un questionnaire de qualité de vie spécifique à la sarcopénie, créé il y a dix ans. Le terme « spécifique » prend tout son sens, car auparavant on utilisait des outils génériques de mesure de la qualité de vie, qui ne mesuraient que partiellement son impact réel. J’ai reçu énormément de sollicitations pour l’utilisation et la traduction de ce questionnaire. Il a ainsi été traduit en plus de quarante langues ! Au vu de cet engouement, j’ai réalisé une méta-analyse qui a montré de manière unanime une diminution nette de la qualité de vie des patients atteints de sarcopénie.
Cet outil est représentatif d’une approche dite « centrée sur le patient ». Comment se concrétise-t-elle ?
La recherche clinique tend à davantage intégrer le patient dans le processus de soin. Si le patient se sent écouté et compris, cela va influencer sa pathologie. Le SarQoL s’inscrit dans cette logique, tout comme la technique du Discrete choice experiment (DCE), à laquelle je m’intéresse particulièrement. Il s’agit d’une étude de préférence de patients en matière de caractéristique de traitement. En effet, il n’existe à ce jour aucun traitement médicamenteux pour traiter la sarcopénie. Ce type d’étude va donc permettre à l’industrie pharmaceutique, mais aussi, agroalimentaire de proposer des traitements pharmacologiques ou des suppléments nutritionnels adaptés aux préférences du patient. En tenant compte de ses préférences, on obtient une meilleure adhérence au traitement, et donc, de meilleurs résultats.
En plus de votre casquette de chercheuse, vous êtes aussi experte en méthodologie. En quoi cela consiste-t-il ?
Les Discrete choice experiment (DCE), comme les méta-analyses, sont des méthodes qui peuvent s’appliquer à de nombreux domaines de recherche. Je suis donc régulièrement contactée par des chercheurs et des cliniciens du monde de la santé, mais pas seulement, pour appliquer concrètement ces outils à leurs thématiques de recherche. Je suis très friande de ce genre de collaborations, qui nourrissent ma curiosité scientifique.
CV express
Charlotte Beaudart est chargée de cours au Département des sciences biomédicales de l’UNamur et membre de l’Institut NARILIS. Lauréate du Prix de la Fondation AstraZeneca, Namuroise de l’année 2024 et titulaire d’un mandat Start-Up Collen-Franqui, elle siège dans plusieurs conseils médicaux belges et internationaux, dont le Belgian Bone Club, le Belgian Aging Muscle Society, l’European Society on Clinical and Economical Aspect of Musculoskeletal Disease et le Global Leadership Initiative in Sarcopenia (GLIS). Elle a récemment rejoint le conseil scientifique de Sciensano et sera prochainement membre du Collège des Jeunes chercheurs de l’Académie royale de Médecine de Belgique. Charlotte Beaudart s'est également vue décerner le prix René de Cooman 2025, une récompense de la Société Belge de Gérontologie et Gériatrie attribuée à de jeunes chercheurs belges pour leur contribution scientifique à la problématique du vieillissement.
Cet article est tiré de la rubrique "L'experte" du magazine Omalius #39 (Décembre 2025).


Un coup d’accélérateur pour la recherche sur le vieillissement grâce à un nouveau mandat Start-up Collen-Francqui pour Charlotte Beaudart
Un coup d’accélérateur pour la recherche sur le vieillissement grâce à un nouveau mandat Start-up Collen-Francqui pour Charlotte Beaudart
Charlotte Beaudart, chargée de cours au Département des sciences biomédicales de la Faculté de médecine, a obtenu le Mandat Start-Up Collen-Francqui ! Une distinction prestigieuse décernée par la Fondation Francqui pour soutenir les jeunes chercheurs prometteurs dans le développement de leur programme de recherche.

Depuis près de quinze ans, Charlotte Beaudart mène des recherches sur les aspects physiologiques du vieillissement, explorant des thématiques telles que la sarcopénie, la fragilité et les capacités intrinsèques.
Grâce à son mandat Start-Up Collen-Francqui, elle pourra désormais consacrer davantage de temps à sa recherche. Temps qu’elle souhaite mettre à profit d’une part pour renforcer sa présence dans les collaborations internationales et interdisciplinaires et d’autre part pour explorer de nouvelles dimensions dans sa recherche sur le vieillissement.« Je souhaiterais explorer la recherche dans le domaine de l’ostéosarcopénie, se définissant par l’association de la sarcopénie et de l’ostéoporose ».
Vers une recherche centrée sur le patient
Charlotte Beaudart défini la majorité de ses recherches comme des recherches dites « patient-centrée ». Son souhait est d’aller plus loin dans cette approche et ainsi « davantage prendre en compte les préférences du patient en termes de modalités thérapeutiques pour adapter les propositions de prise en charge et ainsi espérer une meilleure initiation au traitement et une meilleure adhérence au traitement.»

Ces recherches visent in fine à favoriser une médecine plus personnalisée et humaine. De la sorte, la notion de démocratie s’inclut aussi dans le secteur des soins de santé.
Une expertise en méta-analyse à valoriser
Au cours de sa carrière de chercheuse, Charlotte Beaudart a également développé plusieurs expertises méthodologiques, des compétences en biostatistiques et en méta-synthèse de la littérature scientifique, qui sont transposables à de nombreuses thématiques. « Cela a déjà permis de nombreuses collaborations interdisciplinaires, par exemple avec le département de pharmacie de l’UNamur, mais également avec plusieurs cliniciens travaillant dans des hôpitaux du Namurois », poursuit la scientifique. Ce nouveau mandat lui permettra aussi de développer davantage cet aspect de sa recherche, notamment en formant ses équipes à ces méthodes rigoureuses et en renforçant ses collaborations internes.

Décrypter les mécanismes de résistance du cancer du foie
Décrypter les mécanismes de résistance du cancer du foie
Le carcinome hépatocellulaire est le cancer primitif du foie le plus fréquent. Malheureusement, cette tumeur présente toujours un haut taux de mortalité en raison de l’absence de traitements efficaces contre ses formes les plus avancées ou mal localisées. Dans le cadre d’un partenariat avec le CHU UCL Namur - site de Godinne et avec le soutien de l’entreprise Roche Belgique, les chercheurs et les chercheuses du Département des sciences biomédicales de la Faculté de médecine tentent de comprendre pourquoi les cellules tumorales du foie sont si résistantes aux traitements et d’identifier des alternatives thérapeutiques pour mieux les cibler.
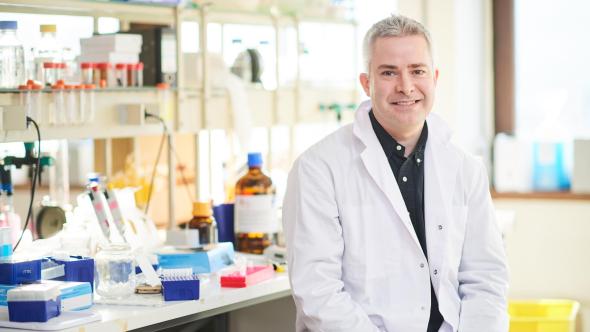
Le foie est le plus grand organe interne de notre corps et il joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions vitales telles que la digestion et la détoxification. De ce fait, bien que malade, le foie est très bien équipé pour résister aux agents chimiques envoyés dans le corps pour le soigner, comme la chimiothérapie. Fort de son expertise dans le domaine de la multirésistance du cancer aux médicaments, le professeur Jean-Pierre Gillet, directeur du Département des sciences biomédicales et du Laboratoire de Biologie Moléculaire du Cancer de l’UNamur, est l’une des chevilles ouvrières d’un nouveau projet de recherche consacré aux mécanismes de résistance du carcinome hépatocellulaire mené en collaboration avec les docteurs Lionel D’Hondt et Quentin Gilliaux, oncologues au Service d’Oncologie médicale du CHU UCL Namur - site de Godinne.
Les récepteurs olfactifs sous la loupe
Ce projet porte sur les récepteurs olfactifs, des protéines localisées dans la membrane des neurones sensoriels de la cavité nasale, mais qui se trouvent aussi exprimés ailleurs dans le corps. Au-delà de leur rôle dans la détection des odeurs, ces récepteurs ont des propriétés hautement intéressantes en matière de traitement : ils constituent en effet des cibles thérapeutiques dites, en anglais, « highly druggable », c’est-à-dire particulièrement réceptives aux médicaments à petites molécules, mais aussi aux médicaments biologiques comme, par exemple, les anticorps. En d’autres mots, ce sont d’excellents candidats pour le développement de médicaments qui peuvent s’y lier efficacement et moduler leur fonction de manière à produire l’effet thérapeutique désiré. Sur base de la littérature existante et des travaux menés précédemment par le professeur Gillet sur le cancer hépatique, s’est posée la question suivante : y aurait-il des récepteurs olfactifs qui seraient spécifiquement exprimés dans la tumeur du foie et, le cas échéant, joueraient-ils un rôle dans son développement et ses mécanismes de résistance aux traitements ?
Pour répondre à cette question, une collaboration interdisciplinaire s’est mise en place entre différents partenaires. La Biobanque du CHU UCL Namur à Godinne, qui conserve des échantillons de tissus prélevés notamment lors de l’ablation de tumeurs, a permis de constituer une collection représentative de foies sains, de foies malades (cirrhotiques) et de tissus tumoraux hépatiques. L’ARN messager a été extrait de ces trois types de tissus, puis séquencé (une méthode qui permet d’identifier les gènes exprimés dans les cellules). L’analyse des données a ensuite été réalisée au sein de la Namur Molecular Tech, plateforme technologique de biologie moléculaire située sur le site universitaire de Godinne et dirigée par le Dr Degosserie. Ce travail a mené à l’identification de six récepteurs olfactifs exprimés spécifiquement dans les cellules tumorales, et jusqu’ici très peu étudiés. Ils constituent donc des candidats prometteurs pour approfondir l’hypothèse de départ : décrypter le rôle de ces récepteurs dans le développement des tumeurs du foie résistantes aux traitements.
Le soutien de Roche Belgium
Grâce à leur expertise conjointe et au caractère novateur de leurs recherches, l’UNamur et le CHU UCL Namur - site de Godinne ont obtenu une bourse de 50.000 € afin de poursuivre l’exploration du rôle de ces six récepteurs olfactifs. En collaboration avec le Laboratoire de recherche du CHU et en particulier la Dr Morgane Canonne, le Laboratoire de Biologie Moléculaire du Cancer de l’UNamur développe actuellement les modèles in vitro, comme les organoïdes, des mini-organes, à partir de biopsies de tumeurs de foie. Ces modèles permettront de tester le rôle biologique des récepteurs olfactifs au sein de la cellule : l’expression de ces récepteurs dans les cellules tumorales induit-elle une augmentation de leur prolifération ou de leur agressivité ? Contribuent-ils à accélérer la génération de métastases dans d’autres tissus ? Ou, au contraire, est-ce une absence d’activation de ces récepteurs qui participe à ces mécanismes ? En fonction de la réponse apportée à ces questions, il sera possible d’évaluer si ces récepteurs constituent de bonnes cibles thérapeutiques au sein de la tumeur primaire du foie en vue de bloquer sa capacité métastatique ou de freiner son développement. Objectif à terme : tester des traitements ciblés sur les cellules de ces modèles, pour envisager la mise au point d’alternatives thérapeutiques qui constitueront un nouvel espoir pour les patients.

Ce projet est le résultat d’une excellente collaboration entre différents partenaires qui, ensemble, ont chacun leur rôle à jouer.
NARILIS, un pont entre l’hôpital et l’université
Fondé en 2010, le Namur Research Institute In Life Sciences (NARILIS) réunit l’Université de Namur et le CHU UCL Namur - site de Godinne. Il fait dialoguer les médecins du CHU avec des scientifiques d’horizons divers, dans une optique résolument interdisciplinaire.
Cet article a été publié dans la newsletter du Fond Namur Université.

Les étudiants de l’UNamur en contact direct avec un astronaute présent dans l’ISS
Les étudiants de l’UNamur en contact direct avec un astronaute présent dans l’ISS
Dans le cadre du cours d’anglais donné en première année de sciences-médecine, les étudiants sont initiés à la vulgarisation de concepts scientifiques sous la forme de vidéos. C’est le projet "It's not Rocket Science", proposé par Natassia Schutz et Aude Hansel, professeures à l'Ecole des Langues Vivantes (ELV) de l'UNamur. Cette année, l'événement de remise de prix du concours a été marqué par un moment fort : une connexion audio en direct avec Donald Pettit, astronaute américain, actuellement à bord de la Station spatiale internationale.

Le projet a pour ambition de rendre la science accessible au plus grand nombre, notamment aux élèves du secondaire. L'objectif est clair : démystifier des concepts scientifiques complexes tout en offrant aux jeunes une porte d’entrée fascinante vers le monde de la recherche.
L'idée derrière "It’s not Rocket Science" est simple mais ambitieuse : chaque duo d'étudiants doit concevoir une vidéo de vulgarisation scientifique de 2 minutes qui explique un concept ou un phénomène scientifique lié à l’espace. Parmi une production de 300 vidéos, les plus convaincantes sont sélectionnées pour participer à un concours organisé pendant le Printemps des Sciences. Les élèves du secondaire sont invités à voter pour la meilleure vidéo.
Les objectifs de ce projet sont multiples : (1) pratiquer l’anglais de manière concrète , (2) offrir un aperçu aux élèves du secondaire de ce qui est réalisé à l’université , (3) découvrir l’interdisciplinarité et (4) donner envie aux jeunes d’étudier les sciences – pourquoi pas à l’UNamur ?
Pour mener à bien ce défi, les étudiants finalistes sont accompagnés dans la réalisation de leurs vidéos par l’équipe de professeurs d’anglais et de disciplines, par le Confluent des Savoirs – service de vulgarisation scientifique de l'UNamur – et par le Service Audio-Visuel.

Édition 2025 : à la découverte de l’espace
Les vidéos produites par les étudiants couvrent des concepts liés à l’espace, une thématique qui captive l’imaginaire et éveille la curiosité et l’intérêt des jeunes. Des effets des radiations cosmiques sur le corps humain, à la quête de nouvelles sources d’énergie dans l’espace ou encore l’étude des volcans sur d'autres planètes, chaque vidéo devient une exploration fascinante d'un sujet complexe, présenté de manière claire et engageante.

Un échange exceptionnel en direct avec la Station spatiale internationale
L'événement de remise de prix du concours a été marqué par un moment fort : une connexion audio en direct avec Donald Pettit, astronaute américain, actuellement à bord de la Station spatiale internationale. Ce moment privilégié d’échange a permis aux étudiants et aux élèves de l’enseignement secondaire présents de poser des questions à l’astronaute en orbite autour de la Terre et d’en apprendre davantage sur la vie à bord, le parcours des astronautes et les défis auxquels ceux-ci font face au quotidien.
Suite à cet échange, les lauréats de l’édition 2025 se sont vu remettre des prix offerts par l’EuroSpace Centre, partenaire du projet. Parmi les 7 vidéos finalistes, c'est celle réalisée par Ella Cishahayo et Angelina Severino, étudiantes en sciences biomédicales, qui a remporté le concours.
La soirée s’est clôturée par une intervention de Julie Henry, Cheffe de projet STEAM à l’UNamur, sur le défi d'attirer les filles dans les filières scientifiques.
Ecouter l'échange avec l'astronaute

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Charlotte Beaudart : Une chercheuse engagée dans le bien vieillir
Charlotte Beaudart : Une chercheuse engagée dans le bien vieillir
Depuis environ une décennie, une maladie attire l’attention de la communauté médicale. Son nom : la sarcopénie. Cette pathologie touche plus de 10 % des plus de 65 ans et se caractérise par une perte importante de la masse et de la force musculaire. Charlotte Beaudart, membre du Département de sciences biomédicales et de l'Institut de recherche NARILIS, s’est imposée sur la scène internationale ces dernières années en contribuant à mieux comprendre cette maladie et à la faire connaître.

Qu’est-ce qui vous a amenée à vous spécialiser dans le domaine du vieillissement ?
Tout a démarré avec ma thèse de doctorat. On m’a proposé de travailler sur la sarcopénie, un sujet alors peu exploré en 2012. C’était le tout début : on commençait seulement à parler de cette maladie. La thématique m’a immédiatement intéressée et j’ai rapidement remarqué que la recherche dans ce domaine était encore à un stade embryonnaire ! J’ai lancé une étude de cohorte sur 530 patients de plus de 65 ans qui ont été suivis durant une dizaine d’années. Ces données ont permis de publier de nombreuses études. C’est seulement en 2016 que la sarcopénie a été reconnue comme une pathologie à part entière. Jusque-là, elle était peu connue du grand public et des professionnels de la santé. De plus, il existait un tas de définitions de la maladie, ce qui entretenait une certaine complexité. J’ai rejoint un groupe d’experts internationaux, le GLIS (Global Leadership Initiative in Sarcopenia), qui travaille actuellement à établir une définition mondiale et consensuelle de la sarcopénie. On avance donc enfin vers une définition claire et une plus grande sensibilisation à la maladie, notamment auprès des médecins.
Justement, comment définit-on la sarcopénie ?
Aujourd’hui, la sarcopénie se définit par une perte progressive et généralisée de force et de masse musculaire avec l’avancée en âge, au-delà du seuil physiologique. Tout le monde perd du muscle en vieillissant, mais on remarque que certains en perdent beaucoup plus que d’autres. Nous cherchons à comprendre cette variabilité interindividuelle, qui est influencée par de nombreux facteurs : génétiques, métaboliques, etc.
Quel est le pourcentage de personnes touchées ?
Cette maladie touche énormément de personnes âgées. On estime ainsi qu’entre 10 et 16 % des plus de 65 ans sont atteintes de sarcopénie. Ce chiffre monte à 60 % pour les personnes hospitalisées, dans un service d’oncologie par exemple.
Pourquoi mérite-t-elle une attention particulière ?
Outre sa prévalence importante, ses conséquences sont lourdes : chutes, fractures, hospitalisations, perte d’autonomie, baisse de la qualité de vie et, c’est très clair, une mortalité accrue. De nombreux travaux commencent également à montrer l’importance des coûts de santé associés à la sarcopénie. L’impact de la sarcopénie se mesure donc au-delà d’un impact individuel, on peut parler d’un véritable impact sociétal !
C’est une question de santé publique sous-estimée selon vous ?
Ça l’était clairement il y a quelques années, mais la situation évolue. La recherche explose et les médias commencent à s’y intéresser. Les politiques y accordent également de plus en plus d’attention, ce qui est très positif. On a tous envie de bien vieillir et de préserver ses capacités physiques.
Vous avez développé un outil spécifique, le SarQol. De quoi s’agit-il ?
Le SarQol est un questionnaire de qualité de vie spécifique à la sarcopénie, créé il y a dix ans. Le terme « spécifique » prend tout son sens, car auparavant on utilisait des outils génériques de mesure de la qualité de vie, qui ne mesuraient que partiellement son impact réel. J’ai reçu énormément de sollicitations pour l’utilisation et la traduction de ce questionnaire. Il a ainsi été traduit en plus de quarante langues ! Au vu de cet engouement, j’ai réalisé une méta-analyse qui a montré de manière unanime une diminution nette de la qualité de vie des patients atteints de sarcopénie.
Cet outil est représentatif d’une approche dite « centrée sur le patient ». Comment se concrétise-t-elle ?
La recherche clinique tend à davantage intégrer le patient dans le processus de soin. Si le patient se sent écouté et compris, cela va influencer sa pathologie. Le SarQoL s’inscrit dans cette logique, tout comme la technique du Discrete choice experiment (DCE), à laquelle je m’intéresse particulièrement. Il s’agit d’une étude de préférence de patients en matière de caractéristique de traitement. En effet, il n’existe à ce jour aucun traitement médicamenteux pour traiter la sarcopénie. Ce type d’étude va donc permettre à l’industrie pharmaceutique, mais aussi, agroalimentaire de proposer des traitements pharmacologiques ou des suppléments nutritionnels adaptés aux préférences du patient. En tenant compte de ses préférences, on obtient une meilleure adhérence au traitement, et donc, de meilleurs résultats.
En plus de votre casquette de chercheuse, vous êtes aussi experte en méthodologie. En quoi cela consiste-t-il ?
Les Discrete choice experiment (DCE), comme les méta-analyses, sont des méthodes qui peuvent s’appliquer à de nombreux domaines de recherche. Je suis donc régulièrement contactée par des chercheurs et des cliniciens du monde de la santé, mais pas seulement, pour appliquer concrètement ces outils à leurs thématiques de recherche. Je suis très friande de ce genre de collaborations, qui nourrissent ma curiosité scientifique.
CV express
Charlotte Beaudart est chargée de cours au Département des sciences biomédicales de l’UNamur et membre de l’Institut NARILIS. Lauréate du Prix de la Fondation AstraZeneca, Namuroise de l’année 2024 et titulaire d’un mandat Start-Up Collen-Franqui, elle siège dans plusieurs conseils médicaux belges et internationaux, dont le Belgian Bone Club, le Belgian Aging Muscle Society, l’European Society on Clinical and Economical Aspect of Musculoskeletal Disease et le Global Leadership Initiative in Sarcopenia (GLIS). Elle a récemment rejoint le conseil scientifique de Sciensano et sera prochainement membre du Collège des Jeunes chercheurs de l’Académie royale de Médecine de Belgique. Charlotte Beaudart s'est également vue décerner le prix René de Cooman 2025, une récompense de la Société Belge de Gérontologie et Gériatrie attribuée à de jeunes chercheurs belges pour leur contribution scientifique à la problématique du vieillissement.
Cet article est tiré de la rubrique "L'experte" du magazine Omalius #39 (Décembre 2025).


Un coup d’accélérateur pour la recherche sur le vieillissement grâce à un nouveau mandat Start-up Collen-Francqui pour Charlotte Beaudart
Un coup d’accélérateur pour la recherche sur le vieillissement grâce à un nouveau mandat Start-up Collen-Francqui pour Charlotte Beaudart
Charlotte Beaudart, chargée de cours au Département des sciences biomédicales de la Faculté de médecine, a obtenu le Mandat Start-Up Collen-Francqui ! Une distinction prestigieuse décernée par la Fondation Francqui pour soutenir les jeunes chercheurs prometteurs dans le développement de leur programme de recherche.

Depuis près de quinze ans, Charlotte Beaudart mène des recherches sur les aspects physiologiques du vieillissement, explorant des thématiques telles que la sarcopénie, la fragilité et les capacités intrinsèques.
Grâce à son mandat Start-Up Collen-Francqui, elle pourra désormais consacrer davantage de temps à sa recherche. Temps qu’elle souhaite mettre à profit d’une part pour renforcer sa présence dans les collaborations internationales et interdisciplinaires et d’autre part pour explorer de nouvelles dimensions dans sa recherche sur le vieillissement.« Je souhaiterais explorer la recherche dans le domaine de l’ostéosarcopénie, se définissant par l’association de la sarcopénie et de l’ostéoporose ».
Vers une recherche centrée sur le patient
Charlotte Beaudart défini la majorité de ses recherches comme des recherches dites « patient-centrée ». Son souhait est d’aller plus loin dans cette approche et ainsi « davantage prendre en compte les préférences du patient en termes de modalités thérapeutiques pour adapter les propositions de prise en charge et ainsi espérer une meilleure initiation au traitement et une meilleure adhérence au traitement.»

Ces recherches visent in fine à favoriser une médecine plus personnalisée et humaine. De la sorte, la notion de démocratie s’inclut aussi dans le secteur des soins de santé.
Une expertise en méta-analyse à valoriser
Au cours de sa carrière de chercheuse, Charlotte Beaudart a également développé plusieurs expertises méthodologiques, des compétences en biostatistiques et en méta-synthèse de la littérature scientifique, qui sont transposables à de nombreuses thématiques. « Cela a déjà permis de nombreuses collaborations interdisciplinaires, par exemple avec le département de pharmacie de l’UNamur, mais également avec plusieurs cliniciens travaillant dans des hôpitaux du Namurois », poursuit la scientifique. Ce nouveau mandat lui permettra aussi de développer davantage cet aspect de sa recherche, notamment en formant ses équipes à ces méthodes rigoureuses et en renforçant ses collaborations internes.

Décrypter les mécanismes de résistance du cancer du foie
Décrypter les mécanismes de résistance du cancer du foie
Le carcinome hépatocellulaire est le cancer primitif du foie le plus fréquent. Malheureusement, cette tumeur présente toujours un haut taux de mortalité en raison de l’absence de traitements efficaces contre ses formes les plus avancées ou mal localisées. Dans le cadre d’un partenariat avec le CHU UCL Namur - site de Godinne et avec le soutien de l’entreprise Roche Belgique, les chercheurs et les chercheuses du Département des sciences biomédicales de la Faculté de médecine tentent de comprendre pourquoi les cellules tumorales du foie sont si résistantes aux traitements et d’identifier des alternatives thérapeutiques pour mieux les cibler.
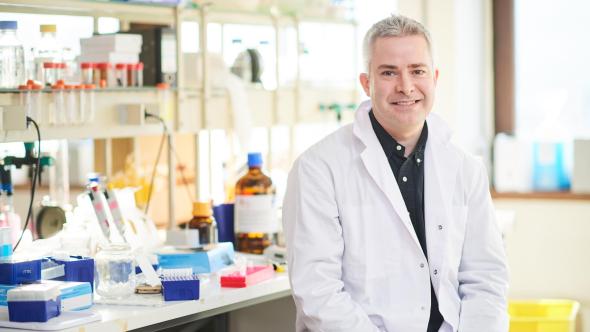
Le foie est le plus grand organe interne de notre corps et il joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions vitales telles que la digestion et la détoxification. De ce fait, bien que malade, le foie est très bien équipé pour résister aux agents chimiques envoyés dans le corps pour le soigner, comme la chimiothérapie. Fort de son expertise dans le domaine de la multirésistance du cancer aux médicaments, le professeur Jean-Pierre Gillet, directeur du Département des sciences biomédicales et du Laboratoire de Biologie Moléculaire du Cancer de l’UNamur, est l’une des chevilles ouvrières d’un nouveau projet de recherche consacré aux mécanismes de résistance du carcinome hépatocellulaire mené en collaboration avec les docteurs Lionel D’Hondt et Quentin Gilliaux, oncologues au Service d’Oncologie médicale du CHU UCL Namur - site de Godinne.
Les récepteurs olfactifs sous la loupe
Ce projet porte sur les récepteurs olfactifs, des protéines localisées dans la membrane des neurones sensoriels de la cavité nasale, mais qui se trouvent aussi exprimés ailleurs dans le corps. Au-delà de leur rôle dans la détection des odeurs, ces récepteurs ont des propriétés hautement intéressantes en matière de traitement : ils constituent en effet des cibles thérapeutiques dites, en anglais, « highly druggable », c’est-à-dire particulièrement réceptives aux médicaments à petites molécules, mais aussi aux médicaments biologiques comme, par exemple, les anticorps. En d’autres mots, ce sont d’excellents candidats pour le développement de médicaments qui peuvent s’y lier efficacement et moduler leur fonction de manière à produire l’effet thérapeutique désiré. Sur base de la littérature existante et des travaux menés précédemment par le professeur Gillet sur le cancer hépatique, s’est posée la question suivante : y aurait-il des récepteurs olfactifs qui seraient spécifiquement exprimés dans la tumeur du foie et, le cas échéant, joueraient-ils un rôle dans son développement et ses mécanismes de résistance aux traitements ?
Pour répondre à cette question, une collaboration interdisciplinaire s’est mise en place entre différents partenaires. La Biobanque du CHU UCL Namur à Godinne, qui conserve des échantillons de tissus prélevés notamment lors de l’ablation de tumeurs, a permis de constituer une collection représentative de foies sains, de foies malades (cirrhotiques) et de tissus tumoraux hépatiques. L’ARN messager a été extrait de ces trois types de tissus, puis séquencé (une méthode qui permet d’identifier les gènes exprimés dans les cellules). L’analyse des données a ensuite été réalisée au sein de la Namur Molecular Tech, plateforme technologique de biologie moléculaire située sur le site universitaire de Godinne et dirigée par le Dr Degosserie. Ce travail a mené à l’identification de six récepteurs olfactifs exprimés spécifiquement dans les cellules tumorales, et jusqu’ici très peu étudiés. Ils constituent donc des candidats prometteurs pour approfondir l’hypothèse de départ : décrypter le rôle de ces récepteurs dans le développement des tumeurs du foie résistantes aux traitements.
Le soutien de Roche Belgium
Grâce à leur expertise conjointe et au caractère novateur de leurs recherches, l’UNamur et le CHU UCL Namur - site de Godinne ont obtenu une bourse de 50.000 € afin de poursuivre l’exploration du rôle de ces six récepteurs olfactifs. En collaboration avec le Laboratoire de recherche du CHU et en particulier la Dr Morgane Canonne, le Laboratoire de Biologie Moléculaire du Cancer de l’UNamur développe actuellement les modèles in vitro, comme les organoïdes, des mini-organes, à partir de biopsies de tumeurs de foie. Ces modèles permettront de tester le rôle biologique des récepteurs olfactifs au sein de la cellule : l’expression de ces récepteurs dans les cellules tumorales induit-elle une augmentation de leur prolifération ou de leur agressivité ? Contribuent-ils à accélérer la génération de métastases dans d’autres tissus ? Ou, au contraire, est-ce une absence d’activation de ces récepteurs qui participe à ces mécanismes ? En fonction de la réponse apportée à ces questions, il sera possible d’évaluer si ces récepteurs constituent de bonnes cibles thérapeutiques au sein de la tumeur primaire du foie en vue de bloquer sa capacité métastatique ou de freiner son développement. Objectif à terme : tester des traitements ciblés sur les cellules de ces modèles, pour envisager la mise au point d’alternatives thérapeutiques qui constitueront un nouvel espoir pour les patients.

Ce projet est le résultat d’une excellente collaboration entre différents partenaires qui, ensemble, ont chacun leur rôle à jouer.
NARILIS, un pont entre l’hôpital et l’université
Fondé en 2010, le Namur Research Institute In Life Sciences (NARILIS) réunit l’Université de Namur et le CHU UCL Namur - site de Godinne. Il fait dialoguer les médecins du CHU avec des scientifiques d’horizons divers, dans une optique résolument interdisciplinaire.
Cet article a été publié dans la newsletter du Fond Namur Université.

Les étudiants de l’UNamur en contact direct avec un astronaute présent dans l’ISS
Les étudiants de l’UNamur en contact direct avec un astronaute présent dans l’ISS
Dans le cadre du cours d’anglais donné en première année de sciences-médecine, les étudiants sont initiés à la vulgarisation de concepts scientifiques sous la forme de vidéos. C’est le projet "It's not Rocket Science", proposé par Natassia Schutz et Aude Hansel, professeures à l'Ecole des Langues Vivantes (ELV) de l'UNamur. Cette année, l'événement de remise de prix du concours a été marqué par un moment fort : une connexion audio en direct avec Donald Pettit, astronaute américain, actuellement à bord de la Station spatiale internationale.

Le projet a pour ambition de rendre la science accessible au plus grand nombre, notamment aux élèves du secondaire. L'objectif est clair : démystifier des concepts scientifiques complexes tout en offrant aux jeunes une porte d’entrée fascinante vers le monde de la recherche.
L'idée derrière "It’s not Rocket Science" est simple mais ambitieuse : chaque duo d'étudiants doit concevoir une vidéo de vulgarisation scientifique de 2 minutes qui explique un concept ou un phénomène scientifique lié à l’espace. Parmi une production de 300 vidéos, les plus convaincantes sont sélectionnées pour participer à un concours organisé pendant le Printemps des Sciences. Les élèves du secondaire sont invités à voter pour la meilleure vidéo.
Les objectifs de ce projet sont multiples : (1) pratiquer l’anglais de manière concrète , (2) offrir un aperçu aux élèves du secondaire de ce qui est réalisé à l’université , (3) découvrir l’interdisciplinarité et (4) donner envie aux jeunes d’étudier les sciences – pourquoi pas à l’UNamur ?
Pour mener à bien ce défi, les étudiants finalistes sont accompagnés dans la réalisation de leurs vidéos par l’équipe de professeurs d’anglais et de disciplines, par le Confluent des Savoirs – service de vulgarisation scientifique de l'UNamur – et par le Service Audio-Visuel.

Édition 2025 : à la découverte de l’espace
Les vidéos produites par les étudiants couvrent des concepts liés à l’espace, une thématique qui captive l’imaginaire et éveille la curiosité et l’intérêt des jeunes. Des effets des radiations cosmiques sur le corps humain, à la quête de nouvelles sources d’énergie dans l’espace ou encore l’étude des volcans sur d'autres planètes, chaque vidéo devient une exploration fascinante d'un sujet complexe, présenté de manière claire et engageante.

Un échange exceptionnel en direct avec la Station spatiale internationale
L'événement de remise de prix du concours a été marqué par un moment fort : une connexion audio en direct avec Donald Pettit, astronaute américain, actuellement à bord de la Station spatiale internationale. Ce moment privilégié d’échange a permis aux étudiants et aux élèves de l’enseignement secondaire présents de poser des questions à l’astronaute en orbite autour de la Terre et d’en apprendre davantage sur la vie à bord, le parcours des astronautes et les défis auxquels ceux-ci font face au quotidien.
Suite à cet échange, les lauréats de l’édition 2025 se sont vu remettre des prix offerts par l’EuroSpace Centre, partenaire du projet. Parmi les 7 vidéos finalistes, c'est celle réalisée par Ella Cishahayo et Angelina Severino, étudiantes en sciences biomédicales, qui a remporté le concours.
La soirée s’est clôturée par une intervention de Julie Henry, Cheffe de projet STEAM à l’UNamur, sur le défi d'attirer les filles dans les filières scientifiques.
Ecouter l'échange avec l'astronaute

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



