DeFIPP consolide les travaux de recherche menés dans trois centres préexistants, le CRED, le CEREFIM et le CERPE, qui représentent chacun l'un des trois grands axes de recherche : l'économie du développement, les politiques publiques et l'économie et la finance régionales, et l'économie monétaire. L'objectif principal de DeFiPP est de promouvoir une recherche d'excellence en économie et en finance, avec une forte visibilité internationale, tout en utilisant la méthodologie économique, à la fois en théorie et en recherche empirique, qui est le lien commun entre les pôles. La fertilisation croisée se fera par le partage commun de nouvelles méthodes ou approches.
L'objectif principal de DeFiPP est de promouvoir l'excellence de la recherche en économie et en finance par le biais de publications scientifiques théoriques et empiriques de premier plan. Pour ce faire, l'institut s'appuie fortement sur les interactions entre les membres de ses trois centres de recherche et encourage le partage de méthodes et d'approches. DeFiPP vise également à développer une visibilité nationale et internationale en collaborant avec des chercheurs de nombreuses universités et de nombreux pays. A cet égard, l'institut, avec plusieurs autres universités belges (KULeuven, UCLouvain et Universiteit Antwerpen), est actuellement impliqué dans le projet Excellence of Science (EOS) qui se concentre sur le développement des connaissances sur les conséquences de la mondialisation et de l'intégration des marchés dans les pays développés et en voie de développement.
À la une
Actualités

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.
Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.
Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.
Les résultats en détail
Appel Equipement
- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain
- Luca Fusaro, Institut NISM
Appel Crédits de recherche (CDR)
- Marc Hennequart, Institut NARILIS
- Nicolas Gillet, Institut NARILIS
- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS
- Patricia Renard, Institut NARILIS
- Francesco Renzi, Institut NARILIS
- Stéphane Vincent, Institut NISM
- Laurence Meurant, Institut NaLTT
- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT
Appel Projets de recherche (PDR)
- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB
- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM
Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)
- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM
- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis
- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE
- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)
- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis
- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM
- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE
Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)
- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions
- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP
- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI
- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.
Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)
- Charlotte Beaudart, Institut Narilis
- Eli Thoré Institut ILEE
Appel WelCHANGE
- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain
- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP
Félicitations à tous et toutes !
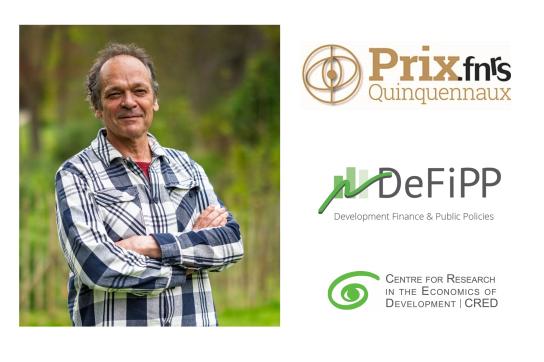
Un prestigieux prix FNRS en sciences sociales pour le Professeur Jean-Marie Baland
Un prestigieux prix FNRS en sciences sociales pour le Professeur Jean-Marie Baland
Le FNRS a décerné le Prix quinquennal Ernest-John Solvay en sciences sociales à Jean-Marie Baland, professeur au Département des sciences économiques de la Faculté EMCP de l’UNamur et cofondateur du Centre de Recherche en Economie du Développement (CRED) de l'Institut DeFiPP. Une reconnaissance majeure pour une carrière consacrée à l’étude des questions de pauvreté, d’institutions informelles et de développement durable.

Le Prix quinquennal Ernest-John Solvay, l’une des distinctions les plus prestigieuses du FNRS, a été attribué ce 24 novembre 2025 à Jean-Marie Baland, professeur au Département des sciences économiques de l’Université de Namur depuis 1991. Ce prix, décerné tous les cinq ans, récompense des chercheurs dont les travaux ont marqué leur discipline par leur originalité et leur impact.
« Jean-Marie Baland allie la rigueur théorique à des études de terrain menées dans des pays tels que l’Inde, le Népal, le Kenya et le Chili. Ses recherches abordent des questions essentielles comme le développement économique, la réduction de la pauvreté et la protection de l’environnement », souligne le jury du FNRS.
Une expertise reconnue internationalement
Spécialiste des pays les moins développés, Jean-Marie Baland a consacré ses travaux à l’analyse des institutions informelles, sujet pour lequel il a obtenu un ERC Advanced Grant en 2009. Ses recherches explorent également les déterminants de la déforestation, les conséquences de la pauvreté, et plus récemment, les causes de la mortalité infantile en Asie du Sud, ou la violence domestique.

La question centrale de mes recherches est de comprendre comment les groupes s’organisent pour la gestion de la prise de décision. Qui en profite ? Qui en est lésé ? Quels impacts cela produit ? J’ai abordé cette thématique sous diverses formes, avec des cas d’études très divers. Par exemple, au Kenya j’ai étudié comment au sein d’un bidonville, un groupement de femmes s’organisaient pour constituer une épargne collective leur permettant de subvenir à leurs besoins. Plus récemment, j’ai étudié le fonctionnement de la prise de décision au sein de couples en Europe. Aujourd’hui, je travaille avec ma collègue Catherine Guirkinger (Faculté EMCP, Département d’économie), sur la question de l’émancipation féminine et de son impact sur la violence domestique : permette-t-elle de la réduire ou de l’augmenter et dans les deux cas pourquoi ? Toutes ces questions sont analysées en s’appuyant sur une méthode interdisciplinaire, avec des approches issues de modèles statistiques, mathématiques et économiques, et des méthodes de sciences sociales comportant des enquêtes de terrain.
L’envie de comprendre le monde
Ce qui le motive depuis toujours ?
« L’envie de comprendre le monde. Ma motivation dans mes recherches a toujours été de produire de la connaissance avant de vouloir qu’elles aient un impact sociétal. L’utilité de la recherche est bien entendu importante, mais personnellement ce n’est pas cela qui me fait avancer. Le résultat de mes recherches est bien entendu régulièrement utilisé pour élaborer des politiques publiques par exemple. Mais cela n’est pas une fin en soi pour mon travail de chercheur », souligne-t-il.
La carrière académique de Jean-Marie Baland a été jalonnée de distinctions prestigieuses : Chaire Francqui (2008), Distinguished Fellow Award à Harvard (2007), membre de l’Academia Europaea (2012)… Autant de reconnaissances qui témoignent de son rayonnement scientifique.
L’UNamur mise en lumière
Mais l’une de ses plus grandes fiertés réside dans la création du centre de recherche en économie du développement (CRED) de l’UNamur, fondée avec le Professeur Jean-Philippe Platteau. Jean-Marie Baland est membre du Centre de recherche en économie du développement (CRED). Un centre aujourd’hui reconnu internationalement pour son expertise en économie du développement, microéconomie appliquée et économie de l’environnement, contribuant à des recherches à fort impact sociétal. « Le CRED compte aujourd’hui cinq académiques et une quinzaine de chercheurs », précise Jean-Marie Baland. L’économiste est aussi un des fondateurs du Master de spécialisation en économie du développement .
A la génération de futurs économistes, Jean-Marie Baland adresse ce souhait :
« Intéressez-vous à des domaines qui ont du sens pour vous ! Et travaillez en équipe, aussi avec des personnes qui pensent différemment de vous. Cette expérience d’interactions humaines a pour ma part été d’une très grande richesse », conclut-il.
Une cérémonie prestigieuse

Ces Prix prestigieux, attribués tous les cinq ans par le FNRS, ont été remis ce 24 novembre 2025 par le Roi Philippe à une chercheuse et cinq chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils confirment la reconnaissance internationale et couronnent la carrière exceptionnelle de ces scientifiques, dans toutes les disciplines. Les Excellentieprijzen du FWO, l’équivalent du FNRS en Flandre, ont également été décernés ce 24 novembre par Sa Majesté le Roi. Lors de cette cérémonie, Véronique Halloin, Secrétaire générale du FNRS, a félicité les lauréats, en remerciant les 42 membres des jurys internationaux mais aussi les mécènes qui rendent possible l’existence de ces Prix. Elle a également évoqué des « questions essentielles pour la recherche scientifique et la société tout entière », insistant sur la nécessité « de conserver le niveau de financement de la recherche fondamentale, de garder toute sa place à une recherche stratégique mais aussi aux sciences humaines et sociales. »
La presse en parle
- Regardez la vidéo de présentation de Jean-Marie Galand (c) The Content Company
- Ecoutez le podcast réalisé par DailyScience avec l’interview de Jean-Marie Baland.
- Téléchargez le communiqué de presse du FNRS.
- Téléchargez la brochure remise lors de la cérémonie

Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable : un programme ancré dans les enjeux contemporains
Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable : un programme ancré dans les enjeux contemporains
Depuis plus de 30 ans, le Département horaire décalé de la Faculté d’Economie Management Communication et sciencesPo (EMCP) de l’Université de Namur accompagne les adultes en reprise d’études dans l’acquisition de nouvelles compétences. En 2023, le Département a ouvert un programme inédit : le Master de spécialisation en management et économie du développement durable. Une formation d’un an qui répond aux défis environnementaux et sociétaux en formant des professionnels pour accompagner la transition écologique et économique.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius de mars 2025.
C’était il y a quatre ans que l’idée d’un tel programme a émergé. Le contexte était alors marqué par la dégradation de la biodiversité et les bouleversements climatiques. Jean-Yves Gnabo, professeur à la Faculté EMCP, ancien directeur du Département HD (2020-2023) et directeur du programme, explique : « Nous avons pris le temps de réfléchir aux mutations sociétales et aux besoins en formation qu’elles génèrent. Il est apparu comme une évidence qu’il fallait accompagner les acteurs du changement, qu’ils soient issus du secteur public, du privé ou encore sous le statut indépendant. Notre positionnement en horaire décalé nous permet donc de les toucher directement. »
Pensé pour s’adapter aux contraintes des adultes en reprise d’études, le programme propose des cours en soirée et le samedi matin, combinant enseignement en présentiel et à distance. L’objectif : permettre aux étudiants de concilier vie professionnelle, familiale et formation. De plus, un encadrement personnalisé est prévu avec des séances d’exercices, un coaching individuel et une coordinatrice pédagogique dédiée. Le programme offre aux étudiants les clés pour décrypter les évolutions majeures au sein des différentes strates de l’économie, leur permettant d’adopter des stratégies plus éclairées et durables.
Une pédagogie innovante et ancrée dans la réalité du terrain
Le Master de spécialisation se distingue par sa volonté de concilier excellence académique et ancrage opérationnel. Dès la conception du programme, l’objectif était clair. « Nous avons cherché à trouver un équilibre entre la rigueur académique et l’application concrète des savoirs. Nos intervenants sont issus à la fois du monde universitaire et du terrain, garantissant une approche multidimensionnelle des problématiques abordées », précise Jean-Yves Gnabo.
Cette volonté se traduit notamment par :
- Un enseignement hybride.
- Des classes inversées (s'exercer en cours et étudier chez soi) et mises en situation réelles, favorisant l’implication active des étudiants.
- Un mémoire de fin d’études avec des axes originaux.
Le mémoire est concrètement le fruit d’une symbiose entre terrain et dimension universitaire. Ainsi, les étudiants peuvent choisir différentes filières. Le professeur Auguste Debroise, encadrant des mémoires, précise : « Trois possibilités sont données aux étudiants : un mémoire terrain, un mémoire recherche et un mémoire entrepreneurial. La première est une formule où des entreprises, des organisations ou des pouvoirs publics vont faire émerger des problématiques rencontrées sur le terrain. Une fois les demandes formulées, nous les soumettons aux étudiants qui en choisissent une en fonction de leurs affinités. Nous pensons que c’est vraiment un moyen de leur offrir une expérience directe de terrain et d’avoir accès à des données réelles, tout en traitant les problématiques avec des concepts plus théoriques et un esprit analytique. La deuxième filière est plus scientifique avec une orientation de recherche classique. On propose donc aux étudiants qui ont un peu plus de sensibilité avec l’approche scientifique de réaliser leur mémoire sur base d’ouvrages sur le sujet. Enfin, la troisième possibilité consiste à laisser aux étudiants qui ont une fibre entrepreneuriale l’opportunité de développer leur projet ou de le mettre en pratique s’il est déjà fortement développé. Ainsi, ils confronteront leur projet ancré dans le réel avec des outils académiques universitaires pour voir à quels besoins réels ils répondent et pour essayer de prendre du recul par rapport à leur projet entrepreneurial et ainsi, développer une pensée critique et réflexive », explique Auguste Debroise.
De même, le séminaire « Transition écologique » est un exemple concret de la ligne de conduite de la formation. En effet, « ce séminaire est basé sur un partage d’expériences avec des intervenants de très haut niveau. Nous avons par exemple accueilli Catharina Sikow-Magny, ancienne directrice de la transition écologique à la Commission européenne », partage Jean-Yves Gnabo. Par ailleurs, d’autres initiatives enrichissantes sont tenues dans le cadre de la formation. C’est le cas notamment du séminaire « Regards croisés », qui reflète une certaine transdisciplinarité grâce à l’exploration des enjeux économiques et environnementaux à travers les regards d’une sociologue, d’une philosophe et d’un politologue. Aussi, des cours importants tels que « Fondement des politiques de l’environnement » et « Évaluation des ressources et des politiques environnementales » sont donnés par le professeur Ludovic Bequet, docteur en économie.
Enfin, le master s’enrichit d’une collaboration avec l’Université du Littoral Côte d’Opale, à Boulogne-sur-Mer, forte d’une expérience de plus de vingt ans dans l’enseignement des transitions économiques et écologiques. « Ce partenariat nous permet de bénéficier de l’expertise de cette université, tout en offrant à nos étudiants une vision plus large des enjeux. Nous avons mis en place un système de partage de cours, où nos étudiants accèdent à des enseignements ciblés dispensés par ses experts, et vice versa », explique Jean-Yves Gnabo.
Un programme évolutif pour rester en phase avec les défis de demain
Au regard des évolutions rapides des enjeux environnementaux et économiques, le Master s’appuie sur un comité de suivi réunissant universitaires et acteurs de terrain. Ce « board » a pour mission d’assurer une veille constante et d’ajuster le programme en fonction des nouvelles problématiques. « Nous avons mis en place des mécanismes permettant de maintenir une formation en prise directe avec la réalité. De plus, l’implication de nombreux experts, qu’ils soient issus d’organisations internationales, d’entreprises ou du monde académique, garantit une approche toujours pertinente et actualisée. Nous avons à peu près une vingtaine d’intervenants, avec des profils comme celui de Géraldine Thiry, Directrice de la Banque Nationale de Belgique, à des profils purement universitaires », partage Jean-Yves Gnabo.
Avec ce nouveau programme, l’UNamur pose les bases d’une formation clé pour répondre aux défis contemporains. Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable se positionne comme un tremplin pour que ses étudiants deviennent des acteurs du changement, armés d’outils solides et d’une vision éclairée du monde en transition. « Ce programme s’adresse à celles et ceux qui veulent non seulement comprendre les défis de notre époque, mais surtout y répondre concrètement. Nous formons les acteurs de la transition, en leur donnant les moyens de décrypter les mutations à l’œuvre et d’agir efficacement au sein de leurs organisations. Notre défi aujourd’hui, c’est acquérir davantage de visibilité », conclut Jean-Yves Gnabo.
Le saviez-vous ?
L’UNamur possède une renommée internationale en économie et gestion, particulièrement dans les domaines du développement durable. Les instituts de recherche DeFIPP et Transitions, reconnus à l’international, étudient d’ailleurs les répercussions de la transition sur la nature et nos sociétés, avec une approche interdisciplinaire.
Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius #36 (Mars 2025).


Un nouvel élan pour les sciences humaines et sociales à l’UNamur
Un nouvel élan pour les sciences humaines et sociales à l’UNamur
A l’UNamur une nouvelle plateforme dédiée à la recherche en sciences humaines et sociales (SHS) voit le jour. Objectif ? Offrir aux chercheuses et chercheurs en SHS, un soutien méthodologique adapté à leurs besoins et renforcer l’excellence en SHS à l’UNamur. Cette plateforme, SHS Impulse, fournira divers services tels qu’un apport financier pour des formations, de la consultance, des accès à des ressources, ou encore des achats de logiciels en cofinancement.

Qu’elles portent sur la linguistique, l’économie, la politique, le développement durable, le droit, l’histoire, les sciences de l’éducation, la littérature, ou encore la traduction, les recherches en sciences humaines et sociales sont autant éclectiques que riches et primordiales pour aborder les enjeux de la société. A l’UNamur sur les onze instituts de recherches que compte l’institution, sept sont directement concernés par la recherche en SHS. Si une forte complémentarité dans ces domaines de recherche est observée, une meilleure mutualisation des moyens, un partage et un accès plus aisé à certains services, ressources, ou supports permettent de soutenir et de renforcer l’excellence de la recherche en SHS à l’UNamur. C’est dans cette optique que la plateforme SHS impulse vient d’être créée.

Nous sommes partis des besoins des chercheurs en SHS pour établir quatre axes développés au sein de cette plateforme
Articulation des ressources autour de 4 axes
- Axe 1 – Soutien à l’acquisition de base de données, ressources documentaires et logiciels
- Axe 2 - Subvention de formations de pointe pour l’utilisation de méthodes spécialisées
- Axe 3 - Cofinancement de l’accès à la plateforme SMCS "Support en Méthodologie et Calcul Statistique" de l’UCLouvain, grâce à un partenariat interuniversitaire.
- Axe 4 - Mise en place d’un espace SHS, contenant un laboratoire pour la passation d’expériences et des outils de travail partagés favorisant les échanges entre chercheurs.
Perspectives
Cette initiative, lancée en janvier 2025, répond aux défis spécifiques rencontrés par les chercheurs en SHS. L’objectif à long terme est de pérenniser et d'élargir les services. « Nous allons aussi engager un chercheur expert en analyse méthodologique en SHS qui pourra informer des méthodologies innovantes et encadrer la conception méthodologique des projets de recherche », souligne Sandrine Biémar, vice-doyenne de la Faculté des Sciences de l'Education et de la Formation de l'UNamur, membre de l’institut IRDENA et du comité de gestion de SHS Impulse. « Le souhait est aussi de soutenir le réseautage entre les chercheurs en SHS de l’UNamur et d’être un levier pour la mise ne place de projet interdisciplinaire », ajoute Sandrine Biémar.
L’équipe de gestion de la plateforme est formée par les représentants des différents instituts SHS de l'université et veille à une gestion efficace des ressources. L'impact de la plateforme sera évalué pendant sa phase initiale (2025-2027), ce qui permettra de définir les stratégies pour sa pérennisation et son développement.

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS
Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.
Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.
Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.
Les résultats en détail
Appel Equipement
- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain
- Luca Fusaro, Institut NISM
Appel Crédits de recherche (CDR)
- Marc Hennequart, Institut NARILIS
- Nicolas Gillet, Institut NARILIS
- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS
- Patricia Renard, Institut NARILIS
- Francesco Renzi, Institut NARILIS
- Stéphane Vincent, Institut NISM
- Laurence Meurant, Institut NaLTT
- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT
Appel Projets de recherche (PDR)
- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB
- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM
Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)
- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM
- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis
- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE
- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)
- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis
- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis
- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM
- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis
- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE
Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)
- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions
- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP
- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI
- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.
Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)
- Charlotte Beaudart, Institut Narilis
- Eli Thoré Institut ILEE
Appel WelCHANGE
- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain
- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP
Félicitations à tous et toutes !
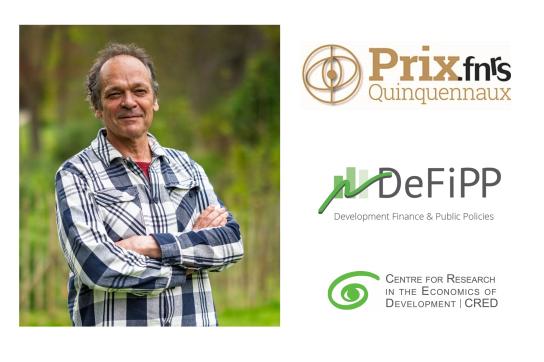
Un prestigieux prix FNRS en sciences sociales pour le Professeur Jean-Marie Baland
Un prestigieux prix FNRS en sciences sociales pour le Professeur Jean-Marie Baland
Le FNRS a décerné le Prix quinquennal Ernest-John Solvay en sciences sociales à Jean-Marie Baland, professeur au Département des sciences économiques de la Faculté EMCP de l’UNamur et cofondateur du Centre de Recherche en Economie du Développement (CRED) de l'Institut DeFiPP. Une reconnaissance majeure pour une carrière consacrée à l’étude des questions de pauvreté, d’institutions informelles et de développement durable.

Le Prix quinquennal Ernest-John Solvay, l’une des distinctions les plus prestigieuses du FNRS, a été attribué ce 24 novembre 2025 à Jean-Marie Baland, professeur au Département des sciences économiques de l’Université de Namur depuis 1991. Ce prix, décerné tous les cinq ans, récompense des chercheurs dont les travaux ont marqué leur discipline par leur originalité et leur impact.
« Jean-Marie Baland allie la rigueur théorique à des études de terrain menées dans des pays tels que l’Inde, le Népal, le Kenya et le Chili. Ses recherches abordent des questions essentielles comme le développement économique, la réduction de la pauvreté et la protection de l’environnement », souligne le jury du FNRS.
Une expertise reconnue internationalement
Spécialiste des pays les moins développés, Jean-Marie Baland a consacré ses travaux à l’analyse des institutions informelles, sujet pour lequel il a obtenu un ERC Advanced Grant en 2009. Ses recherches explorent également les déterminants de la déforestation, les conséquences de la pauvreté, et plus récemment, les causes de la mortalité infantile en Asie du Sud, ou la violence domestique.

La question centrale de mes recherches est de comprendre comment les groupes s’organisent pour la gestion de la prise de décision. Qui en profite ? Qui en est lésé ? Quels impacts cela produit ? J’ai abordé cette thématique sous diverses formes, avec des cas d’études très divers. Par exemple, au Kenya j’ai étudié comment au sein d’un bidonville, un groupement de femmes s’organisaient pour constituer une épargne collective leur permettant de subvenir à leurs besoins. Plus récemment, j’ai étudié le fonctionnement de la prise de décision au sein de couples en Europe. Aujourd’hui, je travaille avec ma collègue Catherine Guirkinger (Faculté EMCP, Département d’économie), sur la question de l’émancipation féminine et de son impact sur la violence domestique : permette-t-elle de la réduire ou de l’augmenter et dans les deux cas pourquoi ? Toutes ces questions sont analysées en s’appuyant sur une méthode interdisciplinaire, avec des approches issues de modèles statistiques, mathématiques et économiques, et des méthodes de sciences sociales comportant des enquêtes de terrain.
L’envie de comprendre le monde
Ce qui le motive depuis toujours ?
« L’envie de comprendre le monde. Ma motivation dans mes recherches a toujours été de produire de la connaissance avant de vouloir qu’elles aient un impact sociétal. L’utilité de la recherche est bien entendu importante, mais personnellement ce n’est pas cela qui me fait avancer. Le résultat de mes recherches est bien entendu régulièrement utilisé pour élaborer des politiques publiques par exemple. Mais cela n’est pas une fin en soi pour mon travail de chercheur », souligne-t-il.
La carrière académique de Jean-Marie Baland a été jalonnée de distinctions prestigieuses : Chaire Francqui (2008), Distinguished Fellow Award à Harvard (2007), membre de l’Academia Europaea (2012)… Autant de reconnaissances qui témoignent de son rayonnement scientifique.
L’UNamur mise en lumière
Mais l’une de ses plus grandes fiertés réside dans la création du centre de recherche en économie du développement (CRED) de l’UNamur, fondée avec le Professeur Jean-Philippe Platteau. Jean-Marie Baland est membre du Centre de recherche en économie du développement (CRED). Un centre aujourd’hui reconnu internationalement pour son expertise en économie du développement, microéconomie appliquée et économie de l’environnement, contribuant à des recherches à fort impact sociétal. « Le CRED compte aujourd’hui cinq académiques et une quinzaine de chercheurs », précise Jean-Marie Baland. L’économiste est aussi un des fondateurs du Master de spécialisation en économie du développement .
A la génération de futurs économistes, Jean-Marie Baland adresse ce souhait :
« Intéressez-vous à des domaines qui ont du sens pour vous ! Et travaillez en équipe, aussi avec des personnes qui pensent différemment de vous. Cette expérience d’interactions humaines a pour ma part été d’une très grande richesse », conclut-il.
Une cérémonie prestigieuse

Ces Prix prestigieux, attribués tous les cinq ans par le FNRS, ont été remis ce 24 novembre 2025 par le Roi Philippe à une chercheuse et cinq chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils confirment la reconnaissance internationale et couronnent la carrière exceptionnelle de ces scientifiques, dans toutes les disciplines. Les Excellentieprijzen du FWO, l’équivalent du FNRS en Flandre, ont également été décernés ce 24 novembre par Sa Majesté le Roi. Lors de cette cérémonie, Véronique Halloin, Secrétaire générale du FNRS, a félicité les lauréats, en remerciant les 42 membres des jurys internationaux mais aussi les mécènes qui rendent possible l’existence de ces Prix. Elle a également évoqué des « questions essentielles pour la recherche scientifique et la société tout entière », insistant sur la nécessité « de conserver le niveau de financement de la recherche fondamentale, de garder toute sa place à une recherche stratégique mais aussi aux sciences humaines et sociales. »
La presse en parle
- Regardez la vidéo de présentation de Jean-Marie Galand (c) The Content Company
- Ecoutez le podcast réalisé par DailyScience avec l’interview de Jean-Marie Baland.
- Téléchargez le communiqué de presse du FNRS.
- Téléchargez la brochure remise lors de la cérémonie

Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable : un programme ancré dans les enjeux contemporains
Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable : un programme ancré dans les enjeux contemporains
Depuis plus de 30 ans, le Département horaire décalé de la Faculté d’Economie Management Communication et sciencesPo (EMCP) de l’Université de Namur accompagne les adultes en reprise d’études dans l’acquisition de nouvelles compétences. En 2023, le Département a ouvert un programme inédit : le Master de spécialisation en management et économie du développement durable. Une formation d’un an qui répond aux défis environnementaux et sociétaux en formant des professionnels pour accompagner la transition écologique et économique.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius de mars 2025.
C’était il y a quatre ans que l’idée d’un tel programme a émergé. Le contexte était alors marqué par la dégradation de la biodiversité et les bouleversements climatiques. Jean-Yves Gnabo, professeur à la Faculté EMCP, ancien directeur du Département HD (2020-2023) et directeur du programme, explique : « Nous avons pris le temps de réfléchir aux mutations sociétales et aux besoins en formation qu’elles génèrent. Il est apparu comme une évidence qu’il fallait accompagner les acteurs du changement, qu’ils soient issus du secteur public, du privé ou encore sous le statut indépendant. Notre positionnement en horaire décalé nous permet donc de les toucher directement. »
Pensé pour s’adapter aux contraintes des adultes en reprise d’études, le programme propose des cours en soirée et le samedi matin, combinant enseignement en présentiel et à distance. L’objectif : permettre aux étudiants de concilier vie professionnelle, familiale et formation. De plus, un encadrement personnalisé est prévu avec des séances d’exercices, un coaching individuel et une coordinatrice pédagogique dédiée. Le programme offre aux étudiants les clés pour décrypter les évolutions majeures au sein des différentes strates de l’économie, leur permettant d’adopter des stratégies plus éclairées et durables.
Une pédagogie innovante et ancrée dans la réalité du terrain
Le Master de spécialisation se distingue par sa volonté de concilier excellence académique et ancrage opérationnel. Dès la conception du programme, l’objectif était clair. « Nous avons cherché à trouver un équilibre entre la rigueur académique et l’application concrète des savoirs. Nos intervenants sont issus à la fois du monde universitaire et du terrain, garantissant une approche multidimensionnelle des problématiques abordées », précise Jean-Yves Gnabo.
Cette volonté se traduit notamment par :
- Un enseignement hybride.
- Des classes inversées (s'exercer en cours et étudier chez soi) et mises en situation réelles, favorisant l’implication active des étudiants.
- Un mémoire de fin d’études avec des axes originaux.
Le mémoire est concrètement le fruit d’une symbiose entre terrain et dimension universitaire. Ainsi, les étudiants peuvent choisir différentes filières. Le professeur Auguste Debroise, encadrant des mémoires, précise : « Trois possibilités sont données aux étudiants : un mémoire terrain, un mémoire recherche et un mémoire entrepreneurial. La première est une formule où des entreprises, des organisations ou des pouvoirs publics vont faire émerger des problématiques rencontrées sur le terrain. Une fois les demandes formulées, nous les soumettons aux étudiants qui en choisissent une en fonction de leurs affinités. Nous pensons que c’est vraiment un moyen de leur offrir une expérience directe de terrain et d’avoir accès à des données réelles, tout en traitant les problématiques avec des concepts plus théoriques et un esprit analytique. La deuxième filière est plus scientifique avec une orientation de recherche classique. On propose donc aux étudiants qui ont un peu plus de sensibilité avec l’approche scientifique de réaliser leur mémoire sur base d’ouvrages sur le sujet. Enfin, la troisième possibilité consiste à laisser aux étudiants qui ont une fibre entrepreneuriale l’opportunité de développer leur projet ou de le mettre en pratique s’il est déjà fortement développé. Ainsi, ils confronteront leur projet ancré dans le réel avec des outils académiques universitaires pour voir à quels besoins réels ils répondent et pour essayer de prendre du recul par rapport à leur projet entrepreneurial et ainsi, développer une pensée critique et réflexive », explique Auguste Debroise.
De même, le séminaire « Transition écologique » est un exemple concret de la ligne de conduite de la formation. En effet, « ce séminaire est basé sur un partage d’expériences avec des intervenants de très haut niveau. Nous avons par exemple accueilli Catharina Sikow-Magny, ancienne directrice de la transition écologique à la Commission européenne », partage Jean-Yves Gnabo. Par ailleurs, d’autres initiatives enrichissantes sont tenues dans le cadre de la formation. C’est le cas notamment du séminaire « Regards croisés », qui reflète une certaine transdisciplinarité grâce à l’exploration des enjeux économiques et environnementaux à travers les regards d’une sociologue, d’une philosophe et d’un politologue. Aussi, des cours importants tels que « Fondement des politiques de l’environnement » et « Évaluation des ressources et des politiques environnementales » sont donnés par le professeur Ludovic Bequet, docteur en économie.
Enfin, le master s’enrichit d’une collaboration avec l’Université du Littoral Côte d’Opale, à Boulogne-sur-Mer, forte d’une expérience de plus de vingt ans dans l’enseignement des transitions économiques et écologiques. « Ce partenariat nous permet de bénéficier de l’expertise de cette université, tout en offrant à nos étudiants une vision plus large des enjeux. Nous avons mis en place un système de partage de cours, où nos étudiants accèdent à des enseignements ciblés dispensés par ses experts, et vice versa », explique Jean-Yves Gnabo.
Un programme évolutif pour rester en phase avec les défis de demain
Au regard des évolutions rapides des enjeux environnementaux et économiques, le Master s’appuie sur un comité de suivi réunissant universitaires et acteurs de terrain. Ce « board » a pour mission d’assurer une veille constante et d’ajuster le programme en fonction des nouvelles problématiques. « Nous avons mis en place des mécanismes permettant de maintenir une formation en prise directe avec la réalité. De plus, l’implication de nombreux experts, qu’ils soient issus d’organisations internationales, d’entreprises ou du monde académique, garantit une approche toujours pertinente et actualisée. Nous avons à peu près une vingtaine d’intervenants, avec des profils comme celui de Géraldine Thiry, Directrice de la Banque Nationale de Belgique, à des profils purement universitaires », partage Jean-Yves Gnabo.
Avec ce nouveau programme, l’UNamur pose les bases d’une formation clé pour répondre aux défis contemporains. Le Master de spécialisation en management et économie du développement durable se positionne comme un tremplin pour que ses étudiants deviennent des acteurs du changement, armés d’outils solides et d’une vision éclairée du monde en transition. « Ce programme s’adresse à celles et ceux qui veulent non seulement comprendre les défis de notre époque, mais surtout y répondre concrètement. Nous formons les acteurs de la transition, en leur donnant les moyens de décrypter les mutations à l’œuvre et d’agir efficacement au sein de leurs organisations. Notre défi aujourd’hui, c’est acquérir davantage de visibilité », conclut Jean-Yves Gnabo.
Le saviez-vous ?
L’UNamur possède une renommée internationale en économie et gestion, particulièrement dans les domaines du développement durable. Les instituts de recherche DeFIPP et Transitions, reconnus à l’international, étudient d’ailleurs les répercussions de la transition sur la nature et nos sociétés, avec une approche interdisciplinaire.
Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow Learn" du magazine Omalius #36 (Mars 2025).


Un nouvel élan pour les sciences humaines et sociales à l’UNamur
Un nouvel élan pour les sciences humaines et sociales à l’UNamur
A l’UNamur une nouvelle plateforme dédiée à la recherche en sciences humaines et sociales (SHS) voit le jour. Objectif ? Offrir aux chercheuses et chercheurs en SHS, un soutien méthodologique adapté à leurs besoins et renforcer l’excellence en SHS à l’UNamur. Cette plateforme, SHS Impulse, fournira divers services tels qu’un apport financier pour des formations, de la consultance, des accès à des ressources, ou encore des achats de logiciels en cofinancement.

Qu’elles portent sur la linguistique, l’économie, la politique, le développement durable, le droit, l’histoire, les sciences de l’éducation, la littérature, ou encore la traduction, les recherches en sciences humaines et sociales sont autant éclectiques que riches et primordiales pour aborder les enjeux de la société. A l’UNamur sur les onze instituts de recherches que compte l’institution, sept sont directement concernés par la recherche en SHS. Si une forte complémentarité dans ces domaines de recherche est observée, une meilleure mutualisation des moyens, un partage et un accès plus aisé à certains services, ressources, ou supports permettent de soutenir et de renforcer l’excellence de la recherche en SHS à l’UNamur. C’est dans cette optique que la plateforme SHS impulse vient d’être créée.

Nous sommes partis des besoins des chercheurs en SHS pour établir quatre axes développés au sein de cette plateforme
Articulation des ressources autour de 4 axes
- Axe 1 – Soutien à l’acquisition de base de données, ressources documentaires et logiciels
- Axe 2 - Subvention de formations de pointe pour l’utilisation de méthodes spécialisées
- Axe 3 - Cofinancement de l’accès à la plateforme SMCS "Support en Méthodologie et Calcul Statistique" de l’UCLouvain, grâce à un partenariat interuniversitaire.
- Axe 4 - Mise en place d’un espace SHS, contenant un laboratoire pour la passation d’expériences et des outils de travail partagés favorisant les échanges entre chercheurs.
Perspectives
Cette initiative, lancée en janvier 2025, répond aux défis spécifiques rencontrés par les chercheurs en SHS. L’objectif à long terme est de pérenniser et d'élargir les services. « Nous allons aussi engager un chercheur expert en analyse méthodologique en SHS qui pourra informer des méthodologies innovantes et encadrer la conception méthodologique des projets de recherche », souligne Sandrine Biémar, vice-doyenne de la Faculté des Sciences de l'Education et de la Formation de l'UNamur, membre de l’institut IRDENA et du comité de gestion de SHS Impulse. « Le souhait est aussi de soutenir le réseautage entre les chercheurs en SHS de l’UNamur et d’être un levier pour la mise ne place de projet interdisciplinaire », ajoute Sandrine Biémar.
L’équipe de gestion de la plateforme est formée par les représentants des différents instituts SHS de l'université et veille à une gestion efficace des ressources. L'impact de la plateforme sera évalué pendant sa phase initiale (2025-2027), ce qui permettra de définir les stratégies pour sa pérennisation et son développement.
Événements
Séminaire "Methods" | Approches computationnelles du changement sémantique
"Methods" est une série de séminaires organisés par l'Institut Transitions de l'Université de Namur dans le but de favoriser la collaboration interdisciplinaire et l'échange de connaissances. Tous les séminaires se déroulent sous forme hybride.
Oratrice : Barbara McGilivray - Senior Lecturer in Digital and Computational Humanities at King's College London
Le changement sémantique, c'est-à-dire l'évolution du sens des mots au fil du temps, offre des informations cruciales sur les processus historiques, culturels et linguistiques. La langue agit comme un miroir des changements sociétaux, reflétant l'évolution des valeurs, des normes et des progrès technologiques. Comprendre comment le sens des mots évolue nous permet de retracer ces transformations et d'acquérir une compréhension plus approfondie de notre passé lointain et récent.
Ce séminaire explore la manière dont les méthodes computationnelles révolutionnent notre capacité à analyser le changement sémantique dans les textes historiques, relevant ainsi un défi majeur dans le domaine des humanités numériques. Si les méthodes computationnelles avancées nous permettent d'analyser de vastes ensembles de données et de mettre au jour des modèles auparavant inaccessibles, rares sont les algorithmes de traitement du langage naturel qui tiennent pleinement compte de la nature dynamique du langage, en particulier de la sémantique, qui est essentielle pour la recherche en sciences humaines. À mesure que les systèmes d'IA se développent pour mieux comprendre le contexte historique et la dynamique du langage, l'annotation et l'interprétation humaines restent essentielles pour saisir les nuances du langage et son contexte culturel.
Dans cette présentation, je montrerai comment les approches computationnelles et centrées sur l'humain peuvent être combinées efficacement pour examiner le changement sémantique et ses liens avec les développements culturels et technologiques. Je présenterai des exemples illustrant comment le changement sémantique peut être analysé à travers les dimensions temporelles, culturelles et textuelles.
Les séminaires "Methods"
Le séminaire sur les méthodes est une série de séminaires organisés à l'Université de Namur dans le but de favoriser la collaboration interdisciplinaire et l'échange de connaissances. Tous les séminaires se déroulent sous forme hybride.
Cette série de séminaires se concentre sur les approches méthodologiques avancées, en particulier dans les domaines du traitement du langage naturel (NLP), de l'intelligence artificielle (IA), de l'analyse vidéo et d'images, et de l'analyse multimodale.
Pour rester informé des détails des prochains séminaires, merci de vous inscrire à notre liste de diffusion ci-dessous.
Les points forts de DeFiPP
- L'intégration de domaines de recherche et d'approches qui différent mais sont liés, tant en économie qu'en finance.
- L'importance des trois centres de recherche de l'institut. En particulier, le CRED est considéré comme un centre de pointe en économie du développement en Europe, et est notamment soutenu par l'Union européenne à travers le European Research Council (ERC) Starting Grant. Le CERPE est connu pour son rôle de conseil dans les politiques publiques belges. Quant au CeReFiM, il a récemment collaboré avec des organisations du secteur privé dans le cadre des chaires de recherche Ageas et BNP Paribas Fortis consacrées à la gestion des risques systémiques et des risques d'actifs.
- L'organisation de diverses activités de recherche qui rassemblent les membres des différents centres de recherche. Ces activités se répartissent en deux catégories : les activités de DeFiPP, par exemple les séminaires hebdomadaires d'économie et les workshops de DeFiPP) et les activités co-organisées avec d'autres universités (par exemple l'atelier de doctorat co-organisé deux fois par an avec l'UCLouvain et l'Université Saint-Louis).
- La participation des trois centres de recherche de la DeFiPP à une école doctorale commune, avec d'autres universités belges, qui permet aux membres de la DeFiPP de suivre des cours de doctorat de haute qualité.




