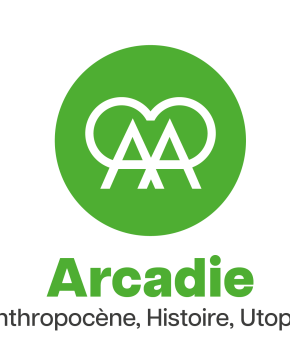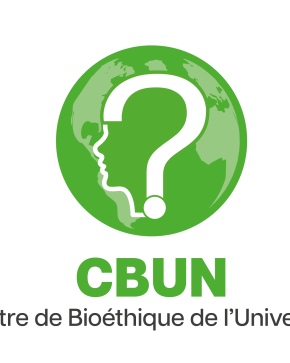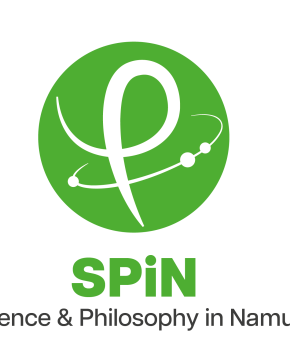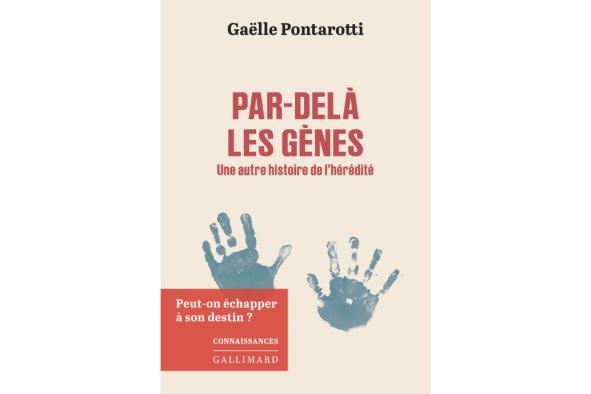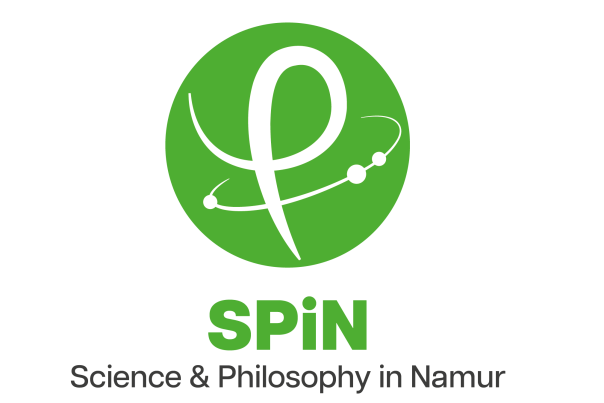Espace transdisciplinaire ouvert sur l’extérieur et destiné à susciter des recherches inédites, ESPHIN aborde des thématiques développées dans ses deux départements fondateurs : celui de Philosophie en Faculté de philosophie et lettres et celui de Sciences-Philosophies-Sociétés en Faculté des sciences.
En synergie avec d’autres entités, les chercheurs visent également l’émergence de nouvelles thématiques dans les grands domaines de la philosophie que sont l’anthropologie, l’éthique, l’esthétique, l’épistémologie, la logique et la métaphysique.
L'Institut ESPHIN entend promouvoir et soutenir des recherches philosophiques, tant fondamentales qu’appliquées.

Les centres de recherche d'ESPHIN
À la une
Événements
Colloque international - Beyond the State: New Perspectives on the Conceptual Relationships Between Constitution and Society
Colloque organisé par Manon Altwegg-Boussac (Paris-Est Creteil University/IUF) et Sabina Tortorella (MSCA/University of Namur) dans le cadre du projet Marie Skłodowska-Curie SOCIAL et de la Chaire Fondamentale Junior de l’Institut Universitaire de France.
Événement gratuit et ouvert au public.
Constitutionalism, understood as a means of establishing a political autonomous from society, is seen as having constructed the opposition between the State and society. At the same time, the concept of constitutionalism is increasingly being used to describe other forms of social power and normativity – such as the economy, finance, digital, technologies, media, environment – even though the concrete and theoretical implications of these shifts have not always been fully clarified. More recent trends have emerged within the framework of socio-constitutionalism or societal constitutionalism to challenge the reduction of constitutional issues to state-individual relations, acknowledging the complexity of power. Despite their heterogeneity in assumptions, as well as in their descriptive, normative, and theoretical dimensions, these approaches have contributed to renew the inquiry into the relationship between constitution and society. The purpose of the conference is to assess the current boundaries of constitutionalism and to explore theoretical proposals seeking to overcome them. These approaches raise several fundamental questions: What role should be granted to social actors and sectors within constitutionalism? How can their normative autonomy be acknowledged while also regulating their private power and expansionist tendencies? To what extent do these transformations challenge traditional forms of politics? At what cost might the relationship between constitution and society be reconsidered today?
Programme
29 janvier
- 9:00 Welcome
- 9:30-10:00 Introduction: Manon Altwegg-Boussac (Paris-Est Creteil University/IUF) and Sabina Tortorella (MSCA/University of Namur)
From State to Society: New Challenges for Constitutionalism
Chair: Isabelle Aubert (Paris Panthéon-Sorbonne University)
- 10:00-10:30 Thomas Boccon-Gibod (Grenoble Alpes University): Relationships between Constitution and Society
- 10:30-11:00 Simone Mao Zhenting (Harvard University): Constitutionalising Society in an Age of Fragmented Authority: From State-Centrism to Social Constitutional Norms
- 11:00-11:30 Discussion
- 11:30-12:00 Coffee Break
- 12:00-12:30 Angelo Jr Golia (Luiss Guido Carli): Societal Constitutionalism and General Theory of Law (beyond the State): Norm, Order, Interpretation
- 12:30-12:45 Discussion
- 12:45-14:30 Lunch
Moving Beyond the Nation-State: Theoretical Perspectives
Chair: Eleonora Bottini (Sciences Po)
- 14:30-15:00 Jean-François Kervégan (Paris Panthéon-Sorbonne University): Politics below and beyond the State: Schmitt and Kojève in Comparative Perspective
- 15:00-15:30 Paul Linden-Retek (University at Buffalo School of Law): Postnational Society and its Law
- 15:30-16:00 Discussion
- 16:00-16:30 Coffee Break
New Conceptual Tools: Alterity and Derogation
Chair: Eleonora Bottini (Sciences Po)
- 16:30-17:00 Horatia Muir Watt (Sciences Po): On the Borderline (and beyond the State): Ontologizing Alterity on the Terms of the Law
- 17:00-17:30 Raffaele Bifulco (Luiss Guido Carli): Derogation as Legal Response to Social Differentiation
- 17:30-18:00 Discussion
- 18:00 Dinner
30 janvier
- 9:00 Welcome
Mapping Sectoral Constitutions: Case Studies
Chair: Sabina Tortorella (MSCA/University of Namur)
- 9:30-10:00 Francesco Martucci (Panthéon-Assas University): Trust and Distrust. State, Society and Money at the Digital Era
- 10:00-10:30 Nefeli Lefkopoulou (Sciences Po): Exploring Constitutional Narratives in Meta’s Oversight Board: Replicating or Renewing Traditional Constitutionalism?
- 10:30-11:00 Discussion
- 11:00-11:30 Coffee Break
- 11:30-12:00 Manuela Niehaus (University of Administrative Sciences Speyer): Global Climate Constitutionalism beyond the State?
- 12:00-12:30 Mathilde Laporte (Pau University): The Debated Protection of Constitutional Rights within Social Orders beyond the State. The Example of Gated Communities
- 12:30-13:00 Discussion
- 13:00-14:30 Lunch
Critical Insights: Take the Leap?
Chair: Manon Altwegg-Boussac (Paris-Est Creteil University/IUF)
- 14:30-15:00 Chris Thornhill (University of Birmingham): The Military in Sociological Constitutionalism
- 15:00-15:15 Discussion
- 15:15-15:45 Coffee Break
- 15:45-16:15 Jörn Reinhardt (Fulda University of Applied Sciences): Regression and Progress in Constitutionalism beyond the State
- 16:15-16:45 Martin Loughlin (LSE): The Concept of Constitution
- 16:45-17:15 Discussion
- 17:15 Cocktail
Les désirs guerriers de la modernité
Dans le cadre de son séminaire, le Centre Arcadie de l'Institut de recherche ESPHIN aura le plaisir de recevoir Déborah V. Brosteaux pour une séance consacrée à son ouvrage Les désirs guerriers de la modernité, Seuil, 2025.
Déborah V. Brosteaux est chercheuse en philosophie à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), membre du Centre de Recherche sur l’Expérience de Guerre (CREG, MSH-ULB) et chercheuse associée au Centre Marc Bloch à Berlin.
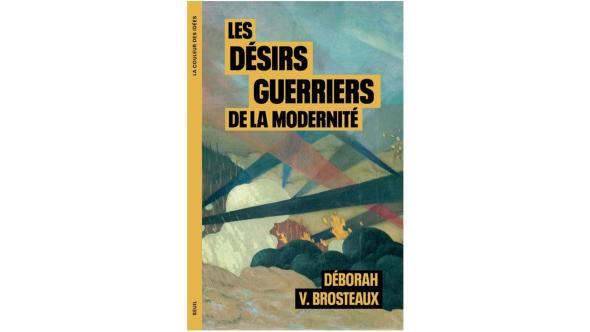
Après une présentation de l'ouvrage, Déborah V. Brosteaux sera interrogée par Thibault De Meyer et Vivien Giet.
Entrée libre. Bienvenue à toutes et tous.
Présentation du livre
Face aux guerres dans lesquelles les pays d’Europe sont impliqués, nous oscillons en permanence entre anesthésie et frénésie. Certaines situations guerrières donnent lieu à un échauffement affectif, un « regain » d’énergies psychiques et sociales, tandis que d’autres sont à peine nommées, reléguées au loin. Cette enquête philosophique creuse l’ambivalence de nos rapports à la guerre, inscrite au coeur de l’histoire sensible de la modernité.
Inspiré des écrits de Walter Benjamin, de W. G. Sebald ou encore de Klaus Theweleit, l’ouvrage explore ces affects guerriers à travers le XXe siècle, et interroge leur héritage : la froideur de la mise à distance, le déni des ruines après 1945, le désir d’intensification de l’expérience de soi, qui mobilise les imaginaires en 1914-1918 et s’engloutit dans les tranchées… voire mute en passions fascistes qui se nourrissent activement de la dévastation.
Déborah V. Brosteaux prend au sérieux ces désirs, y compris dans leurs attraits. Et se demande : quelles transformations affectives activer pour résister aux mobilisations guerrières ?
Savoir et vérité : la formation universitaire à l’époque de la post-vérité
Séance inaugurale de la Chaire Notre-Dame de la Paix 2025-2026 | « Université et société. Que peut le savoir pour le bien commun ? »
Orateurs : Dominique Lambert (UNamur) et Olivier Sartenaer (UNamur)
Après s'être intéressée à la problématique des « Communs », de la gestion des « biens communs » , de la « santé comme bien commun », la Chaire s’arrête cette année sur la problématique du « savoir » comme « bien commun » et du rôle que l’Université est appelée à jouer dans la création et la transmission du savoir.
Comme son titre — « Université et société. Que peut le savoir pour le bien commun ? » — le montre, la valeur et le sens que la société accorde au savoir, encore plus dans une perspective universelle, ne va pas de soi.
Séance inaugurale de la Chaire le 19 février à 18h30 à l'Auditoire S01 (Faculté des sciences, Rue Grafé 2)
ESPHIN, c'est aussi...
Réfléchir
Les recherches philosophiques visent tant à étudier, de manière interdisciplinaire, des problématiques issues des sciences formelles (logique, mathématiques), humaines et de la nature, qu’à construire des problématiques proprement philosophiques dans un espace transdisciplinaire où se trouvent mobilisés les apports des différentes sciences de l’homme (politiques, sociologiques, cliniques,…).
Débattre
ESPHIN se définit aussi comme un lieu de débat, suscitant des rencontres (séminaires, colloques, conférences,…) entre les praticiens et techniciens des sciences susmentionnées et des philosophes afin de mettre en œuvre une inter- et transdisciplinarité effective, fondée sur la conjonction d’une étude approfondie des contenus scientifiques et d’une investigation philosophique de haut niveau.
Enseigner
Partant du principe qu’au sein d’une Université, l’enseignement et la recherche doivent être intimement liés, l'Institut se donne aussi comme mission de faire profiter les étudiants des Baccalauréats (de la Faculté de Philosophie et Lettres, de la Faculté des Sciences et des autres Facultés qui désireraient se joindre à ESPHIN) ou des Maîtrises (de la Faculté des Sciences) du fruit de ses activités de recherche et de leur ouvrir certaines de leurs activités.
Si l'Institut se veut en prise sur des questions « de terrain », il entend préserver avec force la spécificité des approches philosophiques fondamentales intégrant des démarches rigoureuses et exigeantes en histoire de la philosophie.