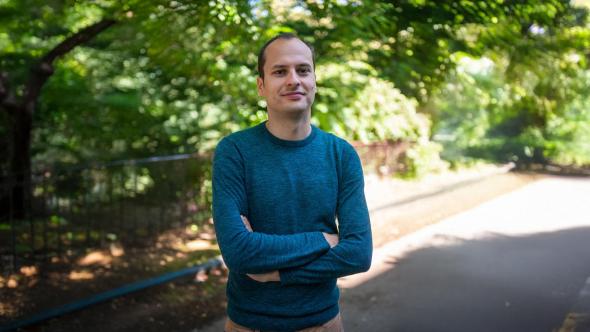Dès lors, la question est de savoir si les gouvernants intègrent vraiment ces processus citoyens dans leurs décisions politiques. « En politique, les choses changent lentement. Il n’est donc pas étonnant qu’on n’assiste pas à de grandes réformes à court terme. Mais cela ne veut pas dire que les résultats ne sont pas pris en compte », nuance le politologue. Dans certains cas, les recommandations issues des assemblées citoyennes nourrissent les politiques publiques. Dans d’autres, elles restent lettre morte. Il précise cependant que l’absence d’impact tient moins à une volonté de manipulation de la part des élus, qu’au fait que la participation soit pensée à côté des circuits de décision.
Pour renforcer leur impact, trois leviers sont identifiés par le chercheur :
- Inscrire les assemblées dans la durée pour nourrir l’action publique sur le long terme.
- Définir en amont le calendrier et la manière dont les décisions vont être prises par rapport aux recommandations citoyennes.
- Garantir un soutien des recommandations par le politique ou la société civile.
L’exemple irlandais est souvent cité. Des assemblées citoyennes ont préparé le terrain à des référendums sur le mariage pour tous et l’avortement. « C’est l’interaction entre les délibérations d’une assemblée tirée au sort, une mobilisation sociale et l’organisation d’un référendum qui a permis de mener à bien ces réformes. »
De quoi rappeler que ces dispositifs ne remplacent pas la démocratie représentative, mais peuvent l’enrichir, à condition de ne pas rester au stade du symbole.