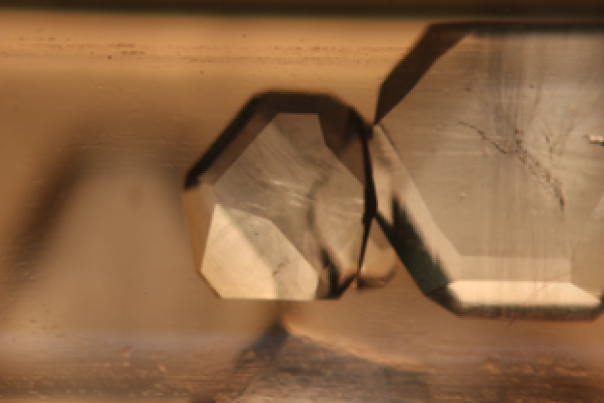Ce projet de recherche (PDR) est une co-promotion des professeurs Tom Leyssens (UCLouvain) et Johan Wouters (UNamur). Il vise à faire entrer le processus de déracémisation par cristallisation dans l'ère de la « chimie verte ».
La déracémisation est un terme utilisé en chimie pour décrire le processus de séparation d'un mélange racémique en ses deux énantiomères, c'est-à-dire les formes chirales (gauche et droite) d'une molécule. Dans l'industrie pharmaceutique, 50 % des composés médicamenteux commercialisés contiennent un centre chiral, essentiel à leur fonctionnement. Lorsqu'un énantiomère a l'effet pharmacologique désiré, l'autre peut être inactif ou avoir des effets indésirables. C'est pourquoi les nouveaux médicaments sont souvent commercialisés sous forme de composés énantiopurs (c’est-à-dire débarrassés de leur « jumeau chiral » impur).
La façon la plus courante d'obtenir des médicaments chiraux implique encore la formation d'un mélange racémique. Il peut alors être produit par des techniques de séparation chimique ou physique, avec une perte de rendement de 50 %. Si le composé en question est « racémisable », l'énantiomère indésirable peut techniquement être retransformé en un mélange racémique, ce qui permet d'obtenir un rendement théorique de 100 %. Au cours de la dernière décennie, diverses méthodologies de déracémisation basées sur la cristallisation ont été développées. Cependant, toutes ces méthodes nécessitent l'utilisation de grandes quantités de solvant car il s'agit de processus de cristallisation.
Cette recherche vise à amener ces processus à un niveau supérieur, non seulement en les rendant plus efficaces (moins chronophages), mais aussi en les faisant entrer dans le domaine de la « chimie verte ». Pour ce faire, les chercheurs proposent des variantes mécano-chimiques pour les conglomérats et les composés racémiques.
Ces procédés seront
- Intrinsèquement ‘verts » puisque l'énantiomère indésirable est transformé en énantiomère désiré ;
- Permis par la mécanochimie qui élimine le besoin de solvant, ce qui les rend plus « verts » que les méthodes basées sur les solutions.
- Les plus « verts » possibles, grâce à leur efficacité (échelle de temps très rapide et faible consommation d'énergie).