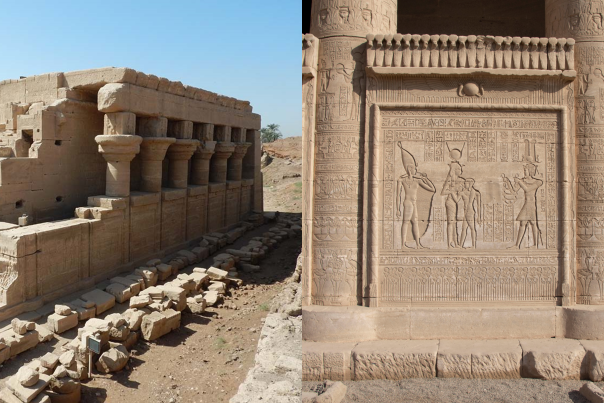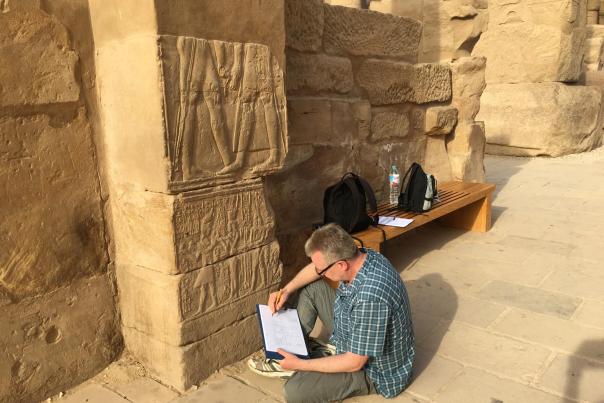Ces vingt dernières années, plusieurs travaux d’artistes photographes ont donné une visibilité aux effets de la radioactivité - principalement suite aux catastrophes nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima -, ou encore aux risques associés à l’enfouissement des déchets radioactifs.
Les séries du Japonais Takashi Arai, du Suisse Julian Charrière, des Français David Fathi, Guillaume Herbaut, Jacqueline Salmon, Anaïs Tondeur et Lucas Chastel, des Allemands Jürgen Nefzger et Wim Wenders ainsi que de la Belge Cécile Massart ont été sélectionnées.
Cinq objectifs sont poursuivis dans cette recherche:
- analyser les contextes de ces productions artistiques ;
- définir les intentions de leurs auteurs, au regard de l’ensemble de leur œuvre et de leur contribution à une culture du nucléaire ;
- étudier les esthétiques de leurs créations, relativement à la matérialité de la photographie, sa nature d’empreinte, de trace, de témoignage ou encore de représentation ;
- évaluer la réception publique de ces œuvres distinctes ;
- contribuer, par la mise en relation dialogique de ces œuvres, leur analyse et leur diffusion, à une culture nucléaire nourrie par l’expression artistique.
Une méthode comparative s’appliquera à l’étude des différentes séries du corpus pour en dégager les spécificités, convergences et/ou divergences, évaluées au regard de la littérature scientifique disponible dans le champ des arts visuels et des sciences humaines sur le nucléaire et ses représentations. Un travail de terrain sera entrepris par le biais d’interviews menés avec chaque photographe.
Dans la perspective des études culturelles, cette recherche s’inscrit dans une démarche d’analyse de la construction des représentations et des savoirs, dégagée de partis pris mais investie dans des débats sociétaux auxquels participent également, par leurs activités respectives, le centre d’art et la maison d’éditions partenaires de ce projet de recherche qui en diffuseront les résultats via :
- une exposition programmée au Centre d’art Le Delta (Namur, mars-juillet 2026)
- une journée d’études associant une partie des artistes exposés (UNamur, mars 2026)
- un ouvrage à paraître aux éditions La Lettre Volée (Bruxelles) (printemps 2026)
Le financement du FNRS permettra de mener à bien les interviews des artistes concernés, tant en Belgique qu’en France et en Allemagne, mais aussi de garantir la diffusion de cette recherche, par le financement d’une partie du livre et de la communication de l’exposition dans lesquels elle prendra forme.