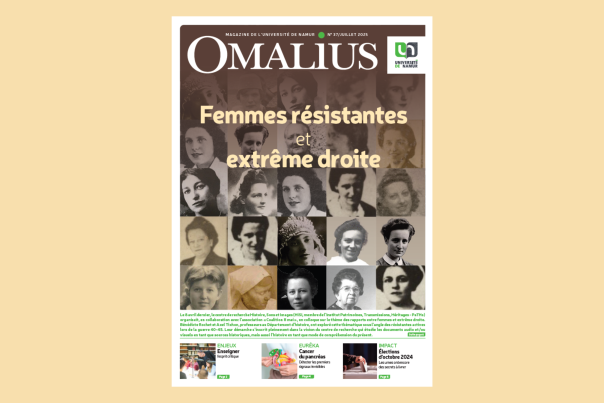Cancer du pancréas : Détecter les premiers signaux invisibles
Souvent détecté trop tard, le cancer du pancréas est l’un des plus agressifs, avec moins de 10 % de survie à cinq ans. À l’Université de Namur, une équipe de chercheurs s’attaque à cette pathologie en étudiant les premiers changements cellulaires liés à la maladie. Objectifs : ouvrir la voie à un dépistage précoce et à de nouvelles pistes thérapeutiques.